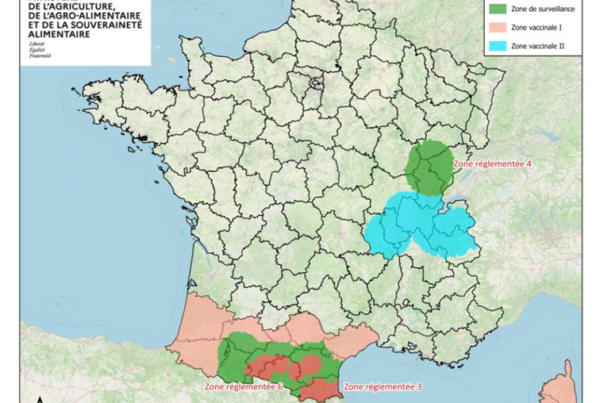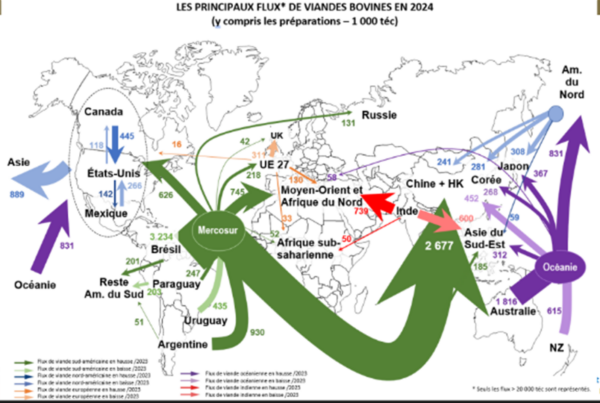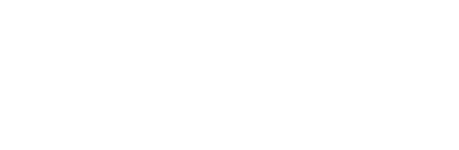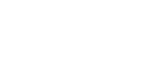La récente hausse des prix des bovins viandeux en ferme par manque d’animaux sur les marchés belge et européen entraîne une hausse des prix de ventes aux consommateurs à cause de la compression des marges des acteurs. Statbel mesurait une hausse des prix de la viande bovine aux consommateurs en Belgique de 12,6 % entre juin 2024 et juin 2025. L’impact de ces hausse sur les achats et les comportements de consommation interroge les acteurs de la filière. Cet article vise à apporter des éléments de réponse.
Une consommation encore largement ancrée… mais qui évolue
En Belgique, la consommation de viande reste dominante : 97 % de la population en consomme. Toutefois, tous les types de viande ne sont pas également représentés. Par exemple, 36 % des francophones ne mangent pas d’agneau. Dans le même temps, les comportements alimentaires évoluent : entre 6 % et 11 % des Belges se déclarent végétariens, un phénomène plus marqué à Bruxelles et chez les moins de 25 ans (données Observatoire de la consommation APAQ-W – YouGov).
Ce changement progressif s’explique par la combinaison de plusieurs préoccupations : santé, bien-être animal, et enjeux environnementaux. En 2023, la consommation apparente de viande s’élevait à 63,1 kg par habitant, dont 27,9 kg achetés dans les points de vente en Belgique (Statbel).
Une demande globalement peu élastique… mais aux nuances nombreuses
De manière générale, la demande en viande est inélastique par rapport aux prix : une hausse des prix n’entraîne qu’une baisse proportionnellement moindre des quantités achetées. Cependant, cette inélasticité varie fortement selon le produit, le contexte ou le profil des consommateurs.
Une élasticité qui dépend de plusieurs facteurs :
- L’espèce animale : la demande en porc (et parfois en volaille) est plus sensible aux variations de prix. À l’inverse, la consommation de bœuf, agneau et poisson est moins affectée.
- Le type de produit : la viande hachée ou transformée n’a pas la même sensibilité au prix que des morceaux nobles.
- L’effet de substitution : lorsque le prix d’une viande augmente, les consommateurs se tournent vers d’autres viandes, d’où une élasticité croisée positive entre les viandes.
- Le prix de base : les produits initialement plus chers présentent une plus forte sensibilité aux hausses de prix (ex. : +10 % sur un produit à 25 € est plus significatif que sur un produit à 10 €).
- L’usage : les produits festifs (ex. filet de bœuf, magret) sont moins sensibles au prix que ceux de consommation courante (cuisses de poulet, haché…) car le prix n’est pas le facteur de choix premier.
Données d’élasticité mesurées
Une étude menée par GfK entre 2017 et 2021 en Belgique révèle :
- Une élasticité moyenne de -0,70 pour la viande dans son ensemble (une hausse de 10 % de prix a entraîné une baisse de 7 % en volumes).
- Une élasticité de -1,09 à -1,16 pour le porc, qui s’avère donc plus sensible au prix.
Les détaillants peuvent aussi influencer la sensibilité au prix : par leur image, leur réputation ou leur positionnement qualité, ils peuvent augmenter le consentement à payer des clients.
Comportements observés en période d’inflation
L’alimentation représente 14 % des dépenses des ménages belges, dont un quart concerne la viande. Contrairement à d’autres postes de dépenses (loisirs, vêtements…), l’alimentation ne peut pas être supprimée, ce qui contraint les consommateurs à adapter leurs stratégies. En période d’inflation, on observe les comportements suivants :
- Descente en gamme (moins de bio, plus de marques distributeurs).
- Recherche de promotions, comparaison entre enseignes.
- Suppression de certains achats, voire saut de repas.
En France, 43 % des consommateurs ont réduit ou arrêté leur consommation de viande en 2022-2023 (étude Ymanci). En Belgique, 31 % des ménages ont déclaré en 2024 avoir rencontré des difficultés à acheter de la viande, du poisson ou des alternatives végétales (Test-Achat).
Les effets sont très marqués selon le niveau de revenu :
- Les ménages modestes consacrent une part plus importante de leur budget à l’alimentation et se tournent vers le hard discount ou les marques de distributeurs, eux-mêmes soumis à des hausses de prix importantes. Résultat : une réduction significative des achats de viande, surtout de viande rouge fraîche.
- Les ménages aisés n’augmentent pas leur consommation mais se dirigent vers des produits plus qualitatifs ou onéreux.
Une relation complexe entre inflation et volumes achetés
L’évolution des volumes achetés ne suit pas toujours mécaniquement l’inflation :
- Les viandes fraîches de bœuf, veau et agneau, avec un prix de départ plus élevé, ont vu leurs volumes chuter – mais partiellement compensés par une hausse des prix.
- Le haché frais ou congelé, pourtant moins cher à l’origine, a fortement souffert de la hausse des prix.
- La viande transformée a vu ses volumes légèrement diminuer, mais sa valeur d’achat a augmenté, notamment pour les produits à base de porc et de volaille.
Il faut également distinguer perception et réalité : en 2024, 95 % des Français estimaient que leur ticket de caisse avait augmenté, alors que les données montrent une stabilisation des prix alimentaires. Cela montre l’importance des facteurs psychologiques dans le comportement d’achat.
Conclusion et perspectives
La hausse des prix agit comme un catalyseur de tendances plus structurelles dans la consommation de viande. Si la demande reste globalement inélastique, elle révèle de fortes disparités selon les espèces, les produits, les contextes économiques et les profils des consommateurs.
L’avenir de la consommation de viande s’inscrit dans un mouvement de fond :
- Une évolution vers les plats préparés et les produits transformés, souvent à base de porc et de volaille.
- Une diminution de la part du bœuf et de l’agneau dans les dépenses de protéines animales.
- Une jeunesse qui consomme moins de viande, surtout rouge, et privilégie les repas extérieurs ou prêts à consommer.
- Une montée des alternatives végétales, qui peinent toutefois à convaincre totalement, car encore perçues comme moins goûteuses, moins pratiques, et pas forcément plus saines.
👉 Ces alternatives sont aujourd’hui vues autant vues comme des substituts directs que comme des compléments aux protéines animales.
En somme, la hausse des prix vient accélérer les évolutions en cours, mais ne détermine pas à elle seule les changements de comportement. Image, praticité, perception de la qualité et enjeux sociétaux pèseront tout autant dans les arbitrages futurs des consommateurs.
Sources
- France AgriMer, 2023. L’impact de l’inflation sur la consommation alimentaire en 2022
- France AgriMer, 2023. La consommation de produits carnés et d’œufs en France en 2022
- France AgriMer, 2025. Viandes, poissons, protéines végétales : seulement une question de prix pour les ménages ?
- Ymanci, 2025. Ymanci lève le voile sur les changement d’habitudes des Français !
- AB REOC, 2024. Welk vlees hebben we in de kuip? Hoe kijken Belgen naar vlees en alternatieven – 2022
- Duquesne et Lebailly, 2003. Evolution de la consommation de viande bovine en Belgique

Quentin Legrand — Chargé de mission Viande Bovine
Email / Publications